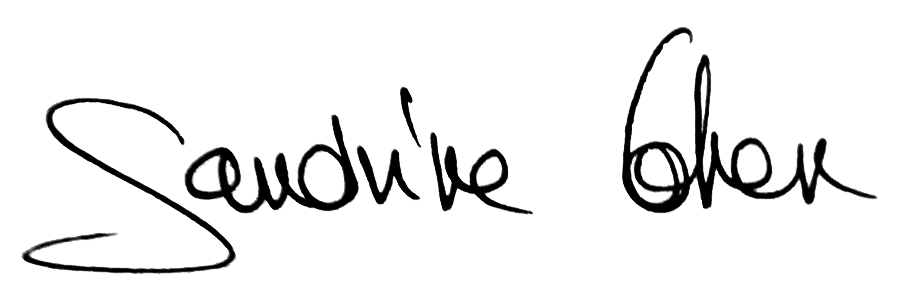Le métro
Le métro. Paris. Ligne 6. Le métro est bondé. Je n’ai pas l’habitude. D’habitude, je prends le métro à toute heure du jour et de la journée, mais pas aux heures de pointe, j’ai un métier qui le permet. Je n’ai pas un métier d’ailleurs, j’ai une vie. Des vies. Je vis. J’écris. Je joue. Je joue, c’est joli. Je réalise aussi. Je me réalise, c’est joli aussi. Le reste du temps, je lis, je vais au cinéma, je regarde des documentaires, je regarde des séries, je parle avec mes amis, je vais à la piscine, au yoga, je m’occupe de mon chat, j’accompagne des qui écrivent ou qui jouent aussi, je donne des formations je prends des cafés, je voyage, je fais des photos, je danse et j’en oublie. Je réfléchis. Je pense le dessin de ma vie. L’absence aujourd’hui d’un homme. D’un enfant. Je pense le monde aussi. Je vis. Et ma vie n’est pas métro, boulot, dodo ça non. Et ça me plait. J’évite le métro bondé. Et ça me va bien. Parfois, je ne peux pas. L’éviter. Le métro bondé. C’est le cas ce jour-là.
Il est 18H. Je sors d’un briefe pour une formation. Je suis passé au Monoprix de la Motte Piquet, j’aime bien les Monoprix, j’ai fait un peu de shopping. J’ai donc un grand sac. Et puis un autre avec mes affaires de piscine. J’ai été à la piscine ce matin, ensuite ma psy et direct le briefe, je ne suis pas repassée chez moi. Et mon sac à main. J’aime mes journées. Faite de bric-à-brac et de tout et n’importe quoi, qui ont ensemble le sens de la liberté. En tout cas voilà, je suis chargée dans le métro bondé. Pas grave. Le métro bondé. Ça ne me dérange pas. Ce n’est pas souvent. Et puis, c’est un peu comme la pluie, hein. Pourquoi se plaindre de ce qu’on ne peut pas changer ? Je me dis ça chaque fois que je prends le métro et qu’il est bondé. Il arrive. Je monte avec mes sacs. Je fais attention à ne pas trop bousculer. Pardon Monsieur, pardon Madame. Ils font la gueule pour la plupart. C’est comme ça. Je comprends en même temps, tous les jours, un métro bondé, matin et soir, ça doit être fatigant, et pas facile pour eux de faire comme moi, contre mauvaise fortune bon cœur comme on dit, vu que pour eux, la mauvaise fortune c’est tous les jours, au jour le jour. Alors bon, je souris. Je me faufile avec mes 3 sacs. Le métro est chargé en fait. Il n’est pas bondé. Je peux bouger. Les pieds. Les mains. Je ne suis pas serrée. Je vise le couloir entre deux carrés. Je préfère. C’est une place tranquille pour lire. J’ai un livre à lire, Tiré d’une histoire vraie de Delphine de Vigan. J’aime lire dans le métro. Je me suis rendu compte que ça me mettait de meilleure humeur que d’être sur mon téléphone. Je me faufile donc. J’avance. Dans le wagon. La plupart des gens sont entassés. Normal je me dis c’est la tête de train, l’endroit où les gens arrivent dans le couloir. C’est marrant, un peu mouton quand même, cette manière de ne pas prendre un autre chemin, de ne pas aller deux wagons plus loin, pour être à l’aise, regarder et changer. Je regarde. De l’autre côté du carré, il y a de la place, beaucoup de place. Une femme se tient devant moi. A l’entrée du couloir. Entre les deux carrés. Je m’excuse, je voudrais juste passer de l’autre côté, il y a de la place, vous voyez. Elle ne bouge pas. A peine. Excusez-moi. Oui, bon. Elle souffle, grogne, râle, hausse les épaules, fait un pas en arrière, me laisse passer. Elle fait contre mauvaise fortune, mauvais cœur. Mais en fait non pourquoi ? Pourquoi le fait que je lui demande de passer serait-il une mauvaise fortune ? Pourquoi le fait que je lui demande de passer devait-il la gêner ? Je ne sais pas mais ça la gêne, c’est évident. Elle me le fait savoir bruyamment. Bon. Pas grave. Vraiment pas grave. Ça n’a rien de personnel. Dans ma tête je me dis, c’est dommage quand même. Dommage d’être si blessée, si abimée, par la vie, par le métro bondé, que même se déplacer pour laisser passer quelqu’un devient une tannée. Je lui souris. M’excuse à nouveau. Rien. Elle est fermée. Au monde. A moi. A elle-même, je crois. Pas grave. Delphine de Vigan m’attend et, de l’autre côté du carré, il y a plus d’air. Je suis encombrée avec mes sacs mais ça ne me dérange pas. Nous sommes le 4 janvier. Il fait beau. Je me sens pleine de la nouvelle année. De ce soleil froid d’hiver. De ce ciel bleu Il y a comme un air de gaité. Une belle lumière. La ligne 6 est aérienne. J’aime bien. J’aime bien le métro aérien, on voit tout Paris. Au loin la tour Eiffel.
Je pose mes sacs part terre. Je prends mon livre. Et je lis. Tranquillement. Une station. Puis deux. Une femme se lève de l’un des carrés. Elle laisse une place assise. C’est bien les places assises, même si certains préfèrent rester debout. La femme est sort de l’autre côté du couloir, du côté de la femme que j’ai dérangée ou plutôt qui a été dérangée. Par moi. La place à côté de la fenêtre est libre. C’est bien. La fenêtre. On voit le ciel. J’attends un peu. Si cette femme veut s’assoir, la place est pour elle, elle était là avant moi. Elle ne bouge pas. Vous voulez vous assoir ? Elle ne me répond pas. OK. Je passe. La femme assise coté couloir se lève à son tour, elle me laisse passer. Je lui souris. Merci. Elle sourit aussi. C’est bien un échange de sourire, ça met du baume au cœur. C’est une bonne fortune et ça éclaire une journée. Parfois une vie. Je m’assois donc. La femme qui m’avait laissé passer s’assoit à côté de moi. Finalement. Elle voulait le côté couloir peut-être. Bon. Voila. Je suis un peu encombrée avec mes sacs. Piscine. Monoprix. Mon sac à main. Avec ma maison dedans. Delphine de Vigan, Elle et Télérama. Mon dossier de formation. Mes trois pochettes. Mes clés. Et mes bonbons. Mon sac. Ma maison. Ma vie. De nomade. D’itinérante. De liberté en liberté. Mais quand même, les sacs, ça prend de la place. Je fais attention. Je ne veux pas déranger. Je pose mes 3 sacs sur mes genoux. Et mon livre par-dessus. Je souris. La femme en face de moi soupire, souffle, râle, son de gorge. Je rapproche encore mes sacs vers moi. Mes jambes aussi. Excusez-moi. Au fond de moi, je me dis que quand même ça fait deux fois, que la parole n’a plus sa place dans le métro qui bondé c’est un fait, mais, en quoi les mots à la place des onomatopées de mécontentement prennent de la place ? Ils en font au contraire, je crois. Oui, je crois que les mots font de la place. A la vérité. A la liberté. Au lien Entre nous. A la compréhension. De l’autre. A l’amour donc. D’une certaine façon. Ils empêchent l’incompréhension, la blessure et même la haine. Il remplace la peur par la compréhension. Et donc par l’amour. Alors oui, les mots font de la place à l’amour d’une certaine façon. Je ne dis pas tout ça. Je dis, excusez-moi. Elle recommence, râle, souffle. C’est beaucoup pour moi. C’est trop. Je n’ai pas l’habitude du métro bondé. J’ai l’habitude de me mêler de ce qui ne me regarde pas. De ce qui me regarde en fait. Les valeurs. Le vivre ensemble. La vie. L’humanité. Je replie un peu plus mes sacs sur moi. Si je vous ai dérangée, je suis désolée, je m’en excuse Mais, vous ne pensez pas que c’est plus simple de le dire gentiment ? Le monde irait mieux non ? Non. Visiblement pas. Elle souffle. Prends à parti la femme à côté de moi, celle qui m’a laissée passée, la première à avoir soufflé. D’ailleurs, c’est peut-être lié ? Une histoire de solidarité ? La mauvaise fortune, mauvais cœur, c’est contagieux. En tout cas, voilà, cette femme soudain, déverse sa blessure pour ne pas dire son venin. La blessure de sa vie de tous les jours, le métro bondé, matin et soir, métro, boulot, dodo. Elle râle. Maugrée. J’insiste. Parce que je suis comme ça. Parce que l’injustice ne me plait pas. Et les mauvais cœurs non plus. Quelques soient les raisons, justifiées ou non. Je lui dis gentiment ce que j’ai sur le cœur. Que nous sommes le 4 janvier. Que c’est le début de la nouvelle année. Que ce serait bien d’être aimable un peu. Que le monde irait mieux si nous étions aimables. Que, soyons gentils entre nous au moins, sinon comment demander aux autres, de l’être ? Je pense à tous ces gens désespérés, qui provoque la peur et donc la haine et parfois, on le sait, peuvent aller très loin, si loin dans la haine, qu’il y a la mort au bout du chemin. Je dis tout ça. Parce que je le crois. Que la bienséance commence par soi. Que je m’excuse encore si je l’ai dérangée mais que voilà, il suffit de le dire gentiment. Vraiment. La femme râle. Maugrée. Je fais l’inverse de ce que je dis avec mes sacs et ma liberté. Je suis sans gêne. Ma voisine renchérit. Que je dérange tout le monde. Mais oui bien sûr. Tout le monde ça fait beaucoup de monde. Tout le monde se tait. Je me tais aussi. Parce que certains combats ne valent pas la peine et que, pour ma part, j’ai dit ce que j’avais à dire.
Je me tais. Je me plonge dans les mots de Delphine de Vigan. Que je ne trouve pas parfaits mais qui sont passionnants. Et qui sont écrit. Et qui font une place à la vie. Les mots font une place à la vie. Prennent de la place dans ma vie. Beaucoup. Les mots pour vivre. Mieux vivre. Bien vivre. C’est sûr. J’ai à peine le temps de lire quelques mots, la femme en face de moi se lève. Elle descend. Tout ça n’aura pris que le temps d’une station. Je me suis assise, elle descendait à la suivante. Tout ça pour ça ? Pour une station ? Tout ça pourquoi ? Pour renvoyer un peu de l’agressivité que cette femme s’est prise toute la journée. Un 4 janvier. Pas le temps de bien commencer l’année. Parce que le métro est bondé et que ça l’étouffe, ça étouffe de le prendre comme ça tous les jours de l’année. Tout ça pourquoi ? Je ne sais pas. Mais d’un coup, ça me rend triste. Si triste. Je me dis que le monde va mal et qu’on ne le sait pas. Que je ne peux rien faire contre ça. Que continuer ma vie. Ma vie à moi. Je me replonge dans Delphine de Vigan. Je me dis que j’écrirais peut-être sur cette histoire. Que parfois les monde à lire sont plus supportable que celui dans lequel on vit. Que c’est peut-être pour ça que j’en écris. Que rien ne me laisse indifférente. Que ce sont des petites choses comme ça qui nous abîme aussi surement qu’un mal au cœur. Que le pire c’est que tout le monde, ou presque, trouve ça normal. J’ai eu de la peine. Je n’ai pas lu. J’ai regardé le ciel. Il faisait beau. Vraiment beau. Un beau soleil. Mais quand même, j’avais envie de pleurer. Sur ce monde où l’on perd ses mots. Ce monde où l’on se perd.